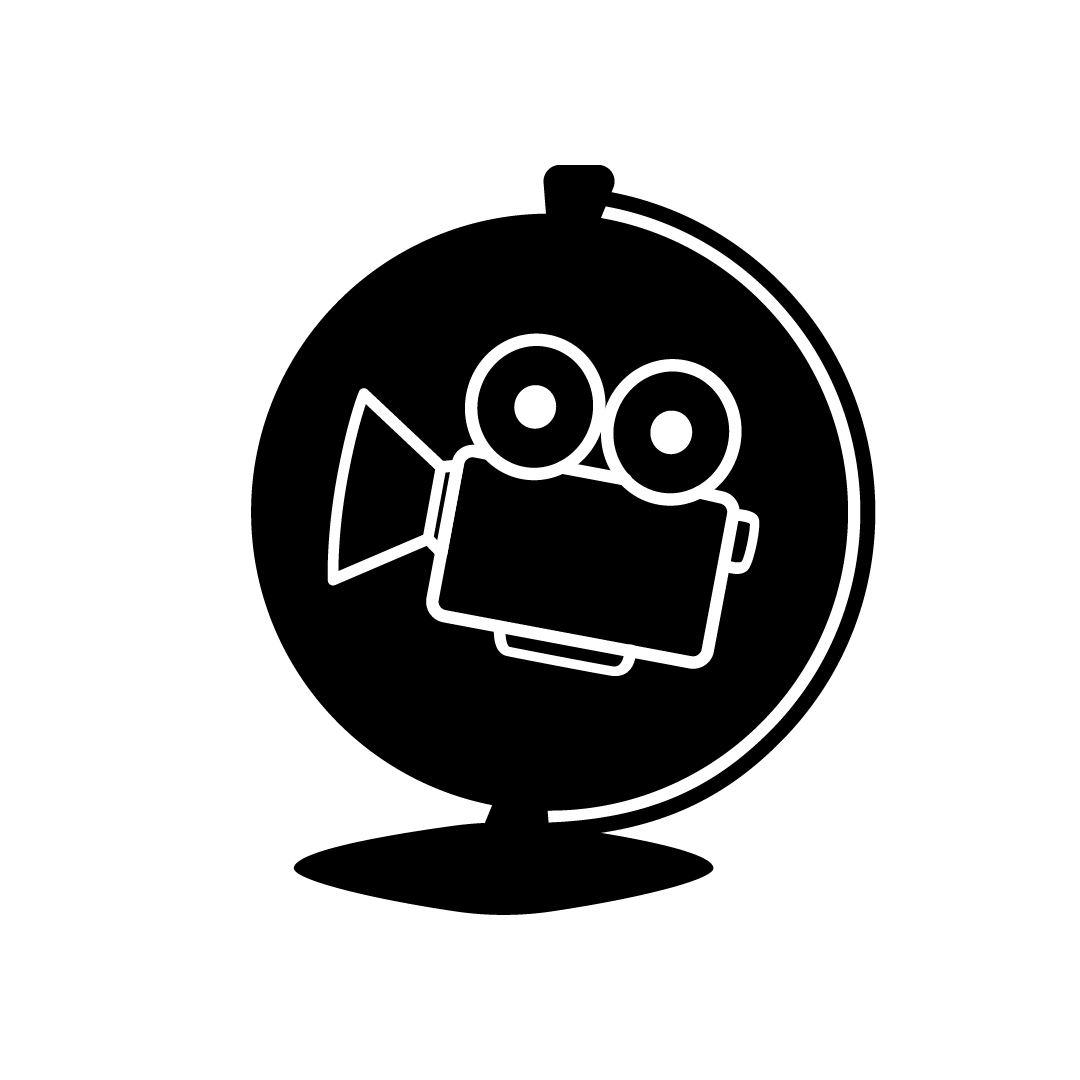La sortie de Black Panther n'a ressemblé à rien d'autre. L'impact, immédiat et durable, était cosmique. Le fait que le film soit sorti pendant les années Trump, une période dystopique de 2018 où la vie des Noirs était plus précaire que d'habitude et où l'appel aux super-héros noirs était plus urgent, a donné à son message une charge particulière. C'était un phénomène trois fois plus grand - un triomphe commercial, critique et culturel.
King T'Challa était un héros d'un nouvel âge pour une époque nouvelle et incertaine. Chadwick Boseman, qui n'est pas étranger aux rôles plus grands que nature, a fait preuve d'équilibre et de charisme aux côtés d'un ensemble de stars comprenant Lupita Nyong'o et Michael B. Jordan. Black Panther avait des dents, et il était assez intelligent pour éviter le piège facile de la représentation dans une industrie affamée de couleur et de sens. Grâce au réalisateur Ryan Coogler et au co-scénariste Joe Robert Cole, le film a été plus qu'un miracle de reconnaissance, il a été la mesure d'un véritable progrès. Il nous a parlé et nous lui avons répondu. De nouveaux avenirs noirs - complexes, luxuriants et libres - s'ouvraient.
Le décès de Boseman, en 2020, des suites d'un cancer du côlon, n'était pas prévu dans l'un de ces avenirs. Les franchises sont construites sur le pouvoir des stars, et sans Boseman, l'un des plus brillants et des plus prometteurs de Marvel, Black Panther : Wakanda Forever est hanté par son absence, drapé dans le genre de chagrin qui ne peut être ignoré. Il est rare que les films du MCU canalisent les turbulences du chagrin avec une attention aussi indéfectible (WandaVision s'en est approché dans sa description non conventionnelle d'un chagrin d'amour conjugal et de ses contrecoups psychologiques). Le positionnement est curieux mais efficace. J'hésite à qualifier Wakanda Forever de nouveau type de super-héros à succès - il n'a pas totalement réinventé la roue - mais il n'en est pas loin. Coogler a doté sa suite d'un nouveau vocabulaire : Il parle aussi bien de la perte que du triomphe. Le chagrin est sa langue maternelle.
Le roi est mort, et les yeux du monde sont à nouveau tournés vers le Wakanda. La reine Ramonda (Angela Bassett) a repris le trône et, au cours de l'année qui a suivi la mort de son fils, elle a fait de son mieux pour maintenir le statut de puissance souveraine de la nation africaine. Seule nation connue à en posséder, le Wakanda reste riche en vibranium - le minerai mystique utilisé pour créer des armes et des technologies de pointe - et refuse de partager ses ressources avec ses alliés (dans une première scène, des soldats français tentent d'en voler et se font rapidement botter le cul par des agents infiltrés de Dora Milaje). La cupidité étant l'étincelle de toutes sortes de conflits à travers l'histoire, Cooler et Cole sont désireux de faire démarrer l'histoire de cette manière. Le gouvernement américain lance une opération de traque du vibranium dans l'océan Atlantique, mais celle-ci est mystérieusement contrecarrée par une puissance inconnue : le peuple de Talokan, un empire sous-marin qui abrite la seule autre source de vibranium sur Terre.
Namor (Tenoch Huerta Mejía) est leur chef blessé, qui tient à garder secrète l'existence de Talokan. Il possède des superpouvoirs de mutant - force accrue, régénération aquatique et vol (grâce aux ailes qu'il porte aux chevilles) - et commande sa nation d'une main méticuleuse, quoique énergique. (L'exploitation minière menace d'exposer son utopie océanique, il élabore donc un plan pour l'arrêter : tuer la scientifique de génie qui a construit le dispositif de traçage du vibranium (Riri Williams, qui introduit Ironheart dans le MCU) et s'aligner avec le Wakanda contre le monde de la surface. Mais le Wakanda refuse. Et les deux nations se retrouvent face à une guerre presque certaine.
Une guerre qui, en fait, n'est pas aussi persuasive que les principes qui l'animent. Comme l'appétit incessant du gouvernement américain pour l'influence mondiale. Ou la rage dévorante que ressent Shuri (Letitia Wright) suite à la perte de son frère, et la façon très réelle dont elle la pousse à agir. Ou comment la méchanceté de Namor, si on peut l'appeler ainsi, est enracinée quelque part de plus profond, de plus humain. Il est taillé dans le tissu des antihéros classiques du MCU. Comme Wanda. Comme Kang. Namor est régalé par le paradoxe et sa colère n'est pas totalement injustifiée. Tout est dans la façon dont son histoire est présentée : Il est le descendant d'une tribu méso-américaine du 16ème siècle qui a fui l'esclavage et a été forcée de trouver refuge sous l'eau. Il est le survivant d'un peuple qui a appris à survivre dans des conditions horribles. Sa morale a du poids.
Toutes les pierres de touche de Coogler sont présentes. Il adopte la même hybridité diasporique qui a fait de la Panthère noire originale un exploit singulier (la conceptrice de production Hannah Beachler et la costumière Ruth Carter sont toutes deux revenues pour la suite). Cette fois, au-delà des champs d'émeraude et des marchés grouillants du Wakanda, c'est l'éden aquatique de Namor qui nous est présenté. Beachler et Carter ont conçu un élixir visuel qui puise dans le folklore maya : les vêtements, le langage et l'architecture sont tous agrémentés de détails indigènes frappants. L'un des grands défauts du film, cependant, est que nous ne passons pas plus de temps à nous promener dans la ville sous-marine, à nous faire une idée de ses habitants et de leur culture.
On m'a déjà dit que les traumatismes se figent au sommet. Il nous demande de tempérer notre rythme, de prendre la mesure de la totalité de ce qui s'est passé, de la douleur qui en résulte. Ramonda et Shuri font de leur mieux pour supporter un chagrin inimaginable, pour se souvenir de ce qu'elles ont perdu. Le fait est que les films de super-héros - leur logique narrative - exigent une certaine dynamique. Ils doivent continuer à avancer. Ils vacillent comme une bande dessinée, planche par planche, sans jamais se reposer trop longtemps avant la scène suivante. Le chagrin nous demande le contraire. Il nous demande de faire une pause, de ralentir nos pas. C'est là que Wakanda Forever est le plus en désaccord : Il a du mal à décider ce qu'il doit ressentir, sur quelle émotion il veut se poser. Mais c'est peut-être le film le plus vrai. Le plus honnête. Il n'est pas aussi ordonné. Il est inconvenant, mais plus vulnérable en conséquence.
L'aspect central qui fait de Wakanda Forever un film Marvel unique - le deuil comme pièce maîtresse - est aussi l'aspect que je trouve le moins satisfaisant. Bien sûr, on ne peut pas l ' ignorer dans un film comme celui-ci. On ne peut pas éviter le brouillard qui se forme et la douleur qui semble ne jamais vouloir partir. On doit l'encercler. Il faut l'affronter de face. D'une certaine façon, on doit en faire l'histoire.
Et ce à quoi cela ressemble, ce à quoi cela se matérialise magnifiquement dans un film comme Wakanda Forever, c'est ce à quoi cela a toujours ressemblé : des femmes noires capables et attentionnées - mères, sœurs et amies - qui utilisent le chagrin qu'elles ont reçu et ne le laissent pas les utiliser. Même dans les utopies afrofuturistes, un fait de la vie noire est obstinément persistant : Même nos super-héros ne peuvent pas déjouer la mort.
Et quand ils ne se révèlent pas invincibles, que se passe-t-il ? Ceux qui restent trouvent un moyen de se battre, de guérir. C'est une histoire vieille comme le monde, et tragiquement trop réelle. Vous l'avez probablement déjà entendue. C'est une histoire qui ne perd jamais son sens.